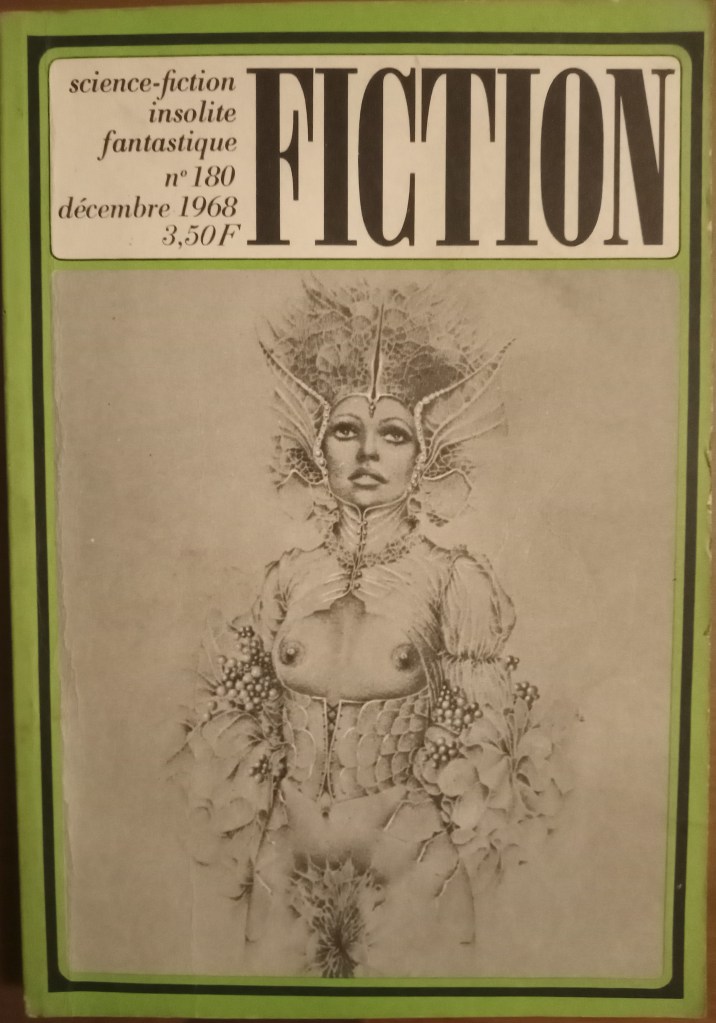
Je fais que relayer les faits historiques.
Ça faisait pas si longtemps, mais j’avais envie. Parce que maintenant que j’ai décidé d’aller à fonds dans l’archéologie littéraire, le plaisir est décuplé.
Et de fait, après autant de numéros plus ou moins explorés, je pense que rallonger la sauce de l’introduction serait indigeste. Alors sautons les hors d’œuvres et plongeons dans le plat principal, voulez vous.
Y a comme qui dirait à boire et à manger : bon appétit !
Dans la chambre sombre, Theodore Sturgeon
On commence en fanfare avec le boss absolu. Ce texte est, je pense, une continuation thématique de l’excellente et surprenante nouvelle dont j’ai pu vous parler dans le Fiction 203 ; avec une réflexion sur les pulsions sombres et inavouées de l’humanité et ce qui se passe quand elle s’y confronte un peu trop frontalement. Et, c’est rigolo, ça se fait dans un numéro sorti après celui qui nous concerne aujourd’hui, mais le texte qui s’y trouve avait initialement été publié avant le texte du jour. Je clair, ne pas ?
Bref. Ici, on a un nouveau témoin de la force de Sturgeon en tant qu’auteur ; on se fait joyeusement balader par une intrigue à la fois extrêmement humaine dans ses termes et ses thèmes premiers, avec une triste mais basique histoire d’adultère surprise, qui à un moment bifurque assez spectaculairement dans le fantastique un peu glauque et désincarné quand le protagoniste comprend que sa femme n’est peut-être responsable en rien de sa faute. Le tout sans jamais perdre en rythme ou en organicité, pour même se permettre le luxe de reboucler sur une fin ouverte à interprétations qui vous fait vous dire que vous pourriez directement relire la nouvelle que vous venez de terminer en la comprenant différemment. C’est à la fois symboliquement et matériellement chargé, c’est impeccable dans l’expression et la verbalisation des enjeux, ça fait tous les bons choix et ça exploite ce qu’ils offrent à fond, c’est superbe. Comme toujours avec le boss, ce qui me sidère avant tout, c’est sa capacité à me raconter des choses très simples avec une classe et une force évocatrice telles que je suis vissé à ma lecture : il faut que je sache, autant par souci de complétion que parce que je trouve toujours l’histoire qu’il me raconte captivante.
Trop fort. Le sans faute continue.
Un gentleman, Gérard Klein
L’ironie mordante faite texte. Si j’ai un petit doute sur le sens que voulait donner Gérard Klein à sa chute, force est de reconnaître qu’encore une fois, il me prouve son talent de novelliste d’anticipation. Je ne peux certes pas gager de ses intentions allégoriques quant à ce texte, il n’empêche qu’il me semble ici avoir bien capté et mobilisé certaines des mécaniques les plus malsaines dirigeant les actions d’une partie trop importante de la population masculine, lui réservant la part du lion de son dédain ; à mon sens pleinement justifié. Je suis un peu mitigé quand à mon sentiment général parce que le doute m’habite quant aux racines qu’il prête aux comportements qu’il me semble ici dénoncer, mais cette dénonciation me paraît trop juste pour pleinement bouder mon plaisir. Tout en me disant qu’il est aussi possible que je projette des questionnements contemporains sur un texte qui à l’époque de sa parution pouvait sonner complètement autrement qu’il sonne aujourd’hui. C’est juste que stylistiquement, c’est tellement ampoulé avec juste ce qu’il faut de distance, ciselé d’une façon trop experte, pour que je n’arrive pas à considérer que Gérard Klein visait autre chose que se moquer de son protagoniste. Et puis même s’il ne se moque pas, il a vu des trucs arriver avec une acuité trop terrible.
Alors en attente d’éléments à charge qui me feraient pencher dans l’autre sens de façon décisive : je décide que j’aime bien cette nouvelle.
Dimanche romain, Lino Aldani
Notons pour commencer ce que je considère être une assez majeure lacune de traduction avec le titre initial de cette nouvelle d’origine italienne : Racconto del 2000 : domenica romana. Même si je ne suis absolument pas adepte de la langue transalpine, je pense quand même en effet que le troncage de cette première partie enlève une partie du sens essentiel du texte de Lino Aldani. En faisant du sous-titre du texte son titre, la traduction fait abstraction de la projection technique de l’anticipation que propose l’auteur ; il inverse sa charge, en faisant un texte littéraire d’anticipation, là où je crois que précisément, il proposait plutôt une pure anticipation qui s’avérait être de forme littéraire, plus particulièrement encore sous une forme fictive.
Alors là comme ça on pourrait croire que je porte agressivement atteinte à la vertu des drosophiles – avec leur consentement, c’est important – mais je vous jure que ça fait sens, parce que ce texte, il est vieux. Et que derrière cet épithète se cachent tout à la fois les qualités et les défauts de cette nouvelle, couvrant basiquement tout le spectre des possibles.
Lino Aldani, ici, se propose de nous dresser un panorama d’anticipation de l’année 2000, qu’il soit social, politique ou technologique, dressé depuis – sauf erreur de ma part après une succincte recherche – l’année 1967 et via le point de vue d’un petit garçon partant passer une journée à la plage avec ses parents ; or cette année 2000 n’est indiquée nulle part dans le texte lui-même.
Et de fait, c’est vieux parce que le futur imaginé par l’auteur, forcément, il accuse le poids des années, pour notre regard à nous : beaucoup de ses idées sont complètement obsolètes et un peu ridicules face à la réalité que nous connaissons désormais. Tout comme il tape terriblement juste quand ses échos sont clairvoyants, aussi rares puissent ils être.
De la même manière, ce texte est vieux dans sa manière de présenter les choses, avec une narration qui m’a semblé très plate, sans doute parce que l’approche de l’auteur se voulait extrêmement naturaliste : il ne s’agissait pas de faire dans l’intrigue ou le spectaculaire, mais de trouver l’axe permettant de couvrir un maximum de terrain thématique avec fraicheur et sincérité ; quoi de mieux alors que la parole innocente d’un gamin qui nous raconte tout sans aucune arrière-pensée ?
C’est le genre de vieux qui souffre artistiquement mais qui gagne culturellement, si j’ose dire : ce qu’il a à dire nous en apprend tellement sur son époque que ses erreurs d’anticipation ne comptent presque plus, et ses réussites sont d’autant plus impressionnantes.
Je ne pourrais pas jurer que je trouve ce texte particulièrement réussi ou que je le considère comme important, mais il m’a quand même apporté quelque chose de rare et de précieux, d’une certaine manière. La preuve, j’en ai fait plus pour lui que pour les deux textes précédents alors qu’il est sans doute le plus court des trois jusque là. C’est le genre de textes pour lesquelles je creuse encore et toujours ces vieilles revues, c’est ceux qui m’en apprennent le plus : parce qu’ils prouvent par leurs existences seules que l’anticipation ne peut que se nourrir du présent, en dépit de toutes les qualités d’imagination de leurs auteurices. Et que je peux me permettre de décortiquer sans crainte du spoil, puisqu’en dépit de la volonté de surprise de certains éléments racontés par l’auteur par le biais de son protagoniste, notamment la toute fin de ce texte précis, leurs enjeux me semblent complètement dépassionnés et dénués de l’effet wow qu’on attend dans certains textes de SF.
Quel. plaisir.
Le caillou, Alain Mark
Court récit qualifié de kafkaïen par l’intro de la rédaction, basé sur une métaphore absurde curieusement bien calibrée, avec son protagoniste se promenant apparemment au hasard en portant son gros caillou à la recherche de son trou ; j’ignore comment ce texte m’a convaincu. Mais il l’a fait. Je suis aussi sincèrement déboussolé par le parti pris de l’auteur qu’étrangement légèrement ému par le résultat. Et je serais bien en peine d’en dire plus ici. Je crois que j’aime bien. C’est ce genre de texte dont le flou est intentionnel, et dans lequel n’importe qui de bonne volonté peut trouver un sens personnel en plissant suffisamment les yeux. Y a une part de poésie et d’universel là dedans qui me parle. Même si, kafkaïcité oblige : c’est un peu lourd.
Après ça, la deuxième partie du roman Le petit peuple de John Cristopher, que je n’ai logiquement pas lue, puisque je n’ai pas la première ni la troisième partie sous la main ; un jour peut-être.
Passons plutôt à la revue des films, située après un cruel encart expliquant au lectorat de la revue que son prix va augmenter à 3,50F à cause de l’augmentation des charges sur la presse. Autre époque, autres prix, mais toujours les mêmes problèmes.
D’abord, un long article signé Bertrand Tavernier(!), titré Lettre d’Angleterre.
Dans le premier paragraphe, il nous livre une intrigante dithyrambe sur le travail du réalisateur Michael Powell, qui révèle avec délice ce qu’était la cinéphilie pré-internet, où l’on devait voyager ou avoir de précieuses connexions professionnelles pour jouir d’une filmographie complète au delà des succès évidents transfrontaliers ; en l’occurrence ici, Le voyeur. J’en retire qu’a priori, ledit Michael Powell n’était pas un clown, et que je serais curieux de voir son Narcisse noir un jour.
On enchaîne avec un petit résumé de Witchfinder general de Michael Reeves, où Vincent Price incarne un chasseur de sorcières aussi sadique qu’impitoyable dans l’Angleterre Cromwellienne. Curiosité morbide insuffisante, ça ira pour moi, mais je suis content de savoir que ça existe, l’anecdote est riche. Par contre, je verrais bien le premier film du réalisateur, il y imitait apparemment tellement bien Roger Corman que ce dernier a cru y voir des plans volés à ses propres films. C’est rigolo.
Et enfin dernier condensé des déceptions de Tavernier qui logiquement ne m’auront pas accroché, au contraire de sa conclusion, se réjouissant d’une adaptation très réussie des Fleurs pour Algernon (version nouvelle) de Keyes par un certain Ralph Nelson. Je note pour plus tard, au cas où.
En P.S, à noter une défense du film La guerre des cerveaux, auparavant attaqué par Alain Garsault dans un précédent numéro de fiction. Ladite défense n’étant pas très épaisse, mais à signaler parce qu’elle est surtout l’occasion d’une attaque d’une sauvagerie rare à l’encontre des Cahiers du Cinéma de la part de Tavernier, les qualifiant de, je cite « sanctuaire de l’imbécilité bouffonne ». Ça se pose là.
Et ensuite, des chroniques plus classiques.
L’enterré vivant de Roger Corman, par Alain Garsault
D’entrée, j’apprends que cette adaptation de Poe fait partie des textes que Baudelaire n’avait pas traduits lui-même, j’apprends donc par la même occasion que ladite traduction n’était pas exhaustive ; on en apprend des choses, c’est merveilleux. Mais j’apprends ensuite, double surprise, que le texte en question contient cette fameuse anecdote de l’homme si terrifié par l’idée d’être enterré vivant qu’il se fait concevoir un cercueil sur mesure qui s’ouvre de l’intérieur et doté d’une cloche d’appel. Donc même si le texte a été traduit bien plus tard par Gallimard, cette idée était quand même assez marquante pour rentrer dans l’imaginaire collectif. Je trouve ça aussi rigolo que passionnant, la question des chemins de traverse de la renommée.
En dehors de ça, je dois dire que je ne suis pas fan de la chronique en elle-même. Si elle me donne un peu envie de voir le film dont il est question, elle me semble surtout beaucoup trop en dire et partir du principe que cielles qui la lisent ont également vu le métrage. J’apprécie le regard technique d’Alain Garsault, mais je trouve son approche un peu trop auto-satisfaite. Dommage.
Gungala, vierge de la jungle de Mike Williams, par Philippe Curval
Quelle angoisse que cette chronique. Je pars avec des préjugés assez négatifs sur Philippe Curval, pour être tout à fait honnête ; mes précédentes rencontres avec son travail de fiction m’ont laissé une image assez peu flatteuse, notamment trop porté sur une vision de la femme et du sexe terriblement vieillies.
Avec un tel titre, vous imaginez assez bien de quoi un film comme celui dont parle Philippe Curval ici. Assez ironiquement, celui-ci commence par dénoncer à demi-mots la vision raciste et colonialiste ayant longtemps présidé à la rédaction de feuilletons déjà anciens à son époque. Pour ensuite, de façon tout aussi couverte, les célébrer tout de même, les comparant avec ses mots à lui à des petits coups d’un soir, en quelque sorte.
Autant dire que le reste de la chronique se contentant de résumer assez pauvrement le film en s’extasiant autant que possible sur la plastique de l’héroïne, aura fini de me fâcher avec son auteur.
Il est assez amusant, finalement, de constater qu’encore plus que les œuvres dont elles parlent, leurs chroniques sont les témoins privilégiées de l’époque qu’elles habitent.
Le vampire, créature du diable et Le créateur de monstres de Sam Newfield, par Alain Garsault
C’est court, et pour cause, ce n’est pas tendre. Le critique livre ici le traitement que je réserve personnellement aux vieux ouvrages avec lesquels le temps a été cruel, autant que le manque de talent ou d’audace de leurs auteurs ; un désossage en règle tempéré par un intérêt historiographique. Au moins, ici, Alain Garsault n’en dit pas trop, mais c’est probablement plus par manque d’intérêt que par souci de pudeur.
Le cimetière des morts-vivants, de Ralph Zucker, par Alain Garsault
Ça donne un peu plus envie, ici, et le chroniqueur me fait me dire que j’ai peut-être été un peu dur avec lui d’entrée de jeu ; il économise mieux les éléments qu’il nous livre. Mais c’est peut-être parce que c’est plus court, encore une fois, ou simplement parce que le film est plus modeste que celui de Corman. Toujours est-il que l’approche technique matinée de subjectivité bien dosée, ça me parle.
L’odyssée du cosmos, de David Lane, par Alain Garsault
Ourf, ça tape dur. Ce film adapté de la série Thunderbirds en prend pour son grade. C’est rigolo, j’étais justement en train de me dire que si l’exercice de ces meta-chroniques était vraiment cool pour moi, il demeurait un poil frustrant à force de me faire me pencher uniquement sur des films dont je n’avais jamais entendu parler. Bon, certes, les Thunderbirds, c’est pas du tout mon époque ni une réelle composante de ma culture, mais c’est quand même quelque chose dont j’ai déjà entendu parler. Du coup, heureux hasard : c’est pas grand chose mais c’est toujours ça.
Bref, Alain Garsault trouve que c’est du gâchis de moyens, que le scénario est stupide, et que tout ça, en gros, manque d’esprit créatif et d’imagination. Ça donne grave envie.
Le fantôme de Barbe-Noire, de Robert Stevenson, par Alain Garsault
Décidemment, monsieur Garsault n’aura pas chômé dans ce numéro ! (Même si bon, trois de ses chroniques sont quand même vachement courtes et laissent à penser qu’elles sont là pour remplir quelques pages autrement laissées vides ou publicisées. Je suis sans doute de mauvais esprit.)
Et je crois que monsieur Garsault n’aime pas les comédies, puisqu’il n’est pas très tendre avec ce film là non plus, taillant un costard sur mesure à Peter Ustinov, interprète du célèbre Edward Teach, revenu d’entre les morts pour aider des vieilles dames à protéger un collège après avoir été invoqué par accident par un jeune coach sportif. Il faut bien admettre que ç’a l’air d’être un peu n’importe quoi.
Et voilà pour le cinéma. À défaut d’y avoir pioché de réelles envies de vieux films, j’y ai appris des choses sur les critiques de la revue, c’est pas mal. Ça m’encourage à continuer de creuser tous mes futurs numéros de la même manière, voire même à revisiter les autres numéros dont je n’ai chroniqué que les textes.
Pour finir en fanfare, voyons du côté du courrier des lecteurs, une première qui promet !
On attaque fort avec le dénommé Christian Seignalet de Béziers, qui nous gratifie d’un littéral retour vers le futur, avec une merveilleuse défense de la SF comme genre à part entière de la littérature, ni meilleur ni pire que les autres, arguant que la SF peut marcher dès lors qu’elle est correctement défendue, citant les succès récents de La Planète des Singes et de Fahrenheit 451 (sous forme de films, quand même, hein). Ensuite, traditionnel couplet sur le fait qu’en France on fait aussi bien que les ricains, d’abord, Wul et Carsac à l’appui ; je ne connais que vaguement le nom du premier. S’en suit une balle perdue très savoureuse envers la fameuse collection Fleuve Noir Anticipation, puis une compensation plus positive envers Galaxie Bis, Présence du Futur et le C.L.A. On finit en expliquant qu’en SF il y en a pour tous les goûts, multiples noms de maîtres anglo-saxons en renfort, sous-genres entre parenthèses pour en rajouter un maximum.
Ce courrier est très drôle pour moi, bien que terriblement ironique, parce qu’il pourrait sortir aujourd’hui avec quelques changements dans les noms, qu’il ne jurerait absolument pas avec le paysage. Le temps passe, mais il semble bien que certaines choses sont vouées à rester pour toujours les mêmes.
Ensuite, un certain G. Paquirri de Bordeaux – j’adore cette précision géographique systématique – nous parle d’opposition entre science-fiction fantastique et science-fiction scientifique, attaquant d’une façon assez intéressante la vision parfois trop scientiste de certaines œuvres ; leur reprochant de trop facilement écarter la psychologie des personnages dès lors qu’ils se meuvent dans l’espace. Cette opposition se loge selon lui dans un clivage culturel entre l’écriture anglo-saxonne et la nôtre, ce que je trouve assez intéressant, bien qu’avec un frisson de rejet de par ma détestation de toute forme d’essentialisme.
M A. Brutsche, de Grenoble, lui, trouve regrettable que Fiction ne semble plus accorder autant d’importance qu’auparavant aux chroniques littéraires. Ou du moins que les chroniques littéraires qui y sont présentes ne se penchent plus assez sur des purs textes de SF comme les « trois Fleuve Noir mensuels » – info précieuse pour moi ! – afin de faire leur travail d’éclaireurs pour les gens qui comme lui voudraient pouvoir faire du tri dans leurs achats et distinguer « le bon grain du mauvais ». Regard intéressant sur la fonction des critiques et des revues qui les hébergent, je trouve.
J’attendais un courrier tel que celui de M J.C. Froelich de Paris ; celui du pinailleur auto-proclamé qui vient expliquer ce qui ne va pas dans les nouvelles qu’il a lues dans un numéro précédent (en l’occurrence le 178). Sachez donc que Daniel Walther ignore tout du métier d’administrateur colonial. Apprenez ensuite que Miriam Allen DeFord n’y connait rien aux hommes de Néanderthal, l’auteur du courrier citant même l’ouvrage d’un homonyme titré La horde de Gor pour appuyer son accusation ; pitié faites que ce ne soit pas un hasard. Il enfonce encore le clou sur les connaissances – ou leurs lacunes, donc – de l’autrice au sujet de la paléontologie et de la période de vie des Néanderthal.
Je trouve ça absolument fascinant de pédanterie auto-satisfaite et d’incompréhension des enjeux de la littérature telle que je la conçois personnellement, c’est merveilleux.
Je passe sur les deux courriers suivants, le premier s’inquiétant simplement de la mainmise de Jacques Goimard sur les notations des sorties cinématographiques récentes et sa subjectivité trop forte dans ses critiques – c’est rigolo, là encore plus les choses changent plus elles restent les mêmes – le second lui regrettant plus simplement, une nouvelle fois, que l’espace consacrées aux critiques s’amenuisent au fil des numéros de Fiction. Je regretterais personnellement, fort logiquement, que la rédaction n’intègre pas à cette rubrique les réponses adéquates à ce genre d’interrogations.
Et nous finissons par le courrier outré de M Bellemin-Noel (de Morsang-sur-Orge, dans l’Essonne) nous expliquant par le menu à quel point la récente traduction de Gabriel, histoire d’un robot, de Domingo Santos, par Denoël, est une honte absolue et une trahison sans bornes de l’œuvre originale. Si je trouve le ton du courrier un brin dramatique, je ne peux pas juger sur pièces de la véracité de ses accusations, donc je vais lui laisser le bénéfice du doute. Mais croyez moi, il est sacrément remonté.
Et je vous laisse tranquille maintenant, je passe sur le référendum de fin de numéro, puisqu’il concerne le n°175 et que je ne l’ai pas lu ; mais j’aime bien ce principe de retour plus circonstancié sur des itérations passées par la rédaction, c’est une façon ludique et intelligente d’impliquer le public ; ça ne peut que permettre d’adapter la suite pour le bénéfice de tout le monde.
Vous savez que plus je me plonge dans ces artéfacts, plus heureux je suis de le faire ? C’est vraiment une manière de me figurer des instantanés temporels, c’est absolument passionnant ; j’ai l’impression d’apprendre tellement de choses, c’est formidable. D’ailleurs, à l’image de la rédaction de Fiction, je vous encourage à me dire ce qui vous intéresse ou non dans ce que je vous retransmets, si vous avez envie de plus ou de moins de détails sur certaines des choses dont je vous parle ; je serais ravi de m’adapter.
Au prochain numéro, donc.
Au plaisir de vous recroiser.
En attendant, que votre avenir soit rempli d’étoiles. 😉
