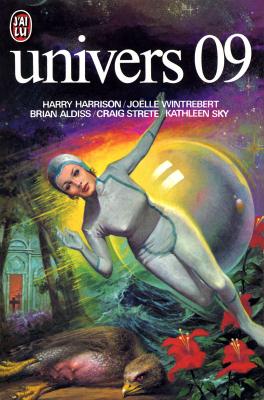
J’avais besoin d’un truc léger pour me remettre de mon mois un peu intense en terme de yoyotage appréciatif (pour ne pas dire qualitatif). Et envie de changer un peu, de me surprendre moi-même. Alors un Univers au lieu d’un Fiction ; chacun ses frissons. Plus besoin d’ergoter sur les pourquoi des comment et tout ça, on embarque direct.
Avec quand même un petit aparté – parce qu’on ne se refait pas – sur l’édito signé Yves Frémion ; et sur pourquoi, rien que dans ces deux petites pages, on peut dénicher un concentré de ce que je peux trouver si fascinant avec ces vieilles revues, même si c’est parfois âpre. Et en deux pages, une intro bien sexisto-paternaliste mépriso-libidineuse envers les deux autrices de ce numéro, suivie d’un sommaire plus précis du numéro, avec en conclusion une plaidoirie assez bien tournée sur la nécessité de la politisation de la SF et de l’art en général. La dissonance cognitive, vue d’ici, est totale. Et si ça fait un peu mal aux valeurs et à la tête, ponctuellement, force est de reconnaître que ça reste captivant.
Mais bref : les textes.
Élégie de l’oiseau Keeku, Kathleen Sky
Un texte qui a le mérite de tenter quelque chose à fond. On y suit ce qu’on devine être une sorte de chienne, membre d’une société organisée autour d’une tradition présidée par des Anciens, et dont les règles sont aussi strictes que ponctuellement cruelles. C’est plutôt bien foutu dans le côté profondément autre, de la narration à la thématique, en passant par l’atmosphère forcément étrange induite par des choix très forts. L’autrice ne nous prend pas par la main à tout nous expliquer, et on doit compléter le puzzle au fur et à mesure que les pièces nous sont présentées ; c’est dépaysant et déstabilisant, mais d’une manière assez élégante, en dépit du côté parfois très cru du récit. J’ai bien aimé, notamment, je crois, grâce à l’extrême précision de la trajectoire du personnage, pour ce qu’elle permettait, par l’autre bout de sa perspective, de toucher à une forme d’allégorie, ou du moins de faire résonner des idées assez universelles.
Après, à noter que j’ai trouvé la chute assez abrupte et bizarre, notamment parce que la mise en page très ric-rac d’Univers me pousse à douter que le récit a été complètement retranscrit. J’imagine bien qu’il est effectivement intégral, mais il manque juste d’un petit espace en fin de page, une respiration visuelle, pour aller avec la respiration finale de la narration elle-même.
J’associe à cette impression curieuse le constat que les traducteurices des textes de la revue ne sont pas indiqué·e·s à la fin de leurs textes respectifs, mais dans un coin discret de la première page de chaque itération.
Mais bref : c’était particulier, comme texte, mais un particulier franchement intriguant. De la bonne.
Bonne nuit les petits… Harry Harrison
Je crois que c’est un texte plutôt bon dans le contexte de son époque. Aujourd’hui, les réflexions politiques et philosophiques autour du conditionnement dès l’enfance à l’aide de programmes informatiques ou d’endoctrinement subliminal sont absolument ringardes parce que complètement et logiquement débunkées. Du coup, ici, tout semble bêtement raccourci, quand bien même l’idée de base n’est pas complètement ridicule. Avec le recul des années et des progrès scientifiques autour de toutes ces questions, forcément, c’est assez has-been, tout ça. Après, le coup du nounours robotique compagnon des enfants comme vecteur d’éducation profonde, c’est un concept pas totalement naze, pour ne pas dire assez sympathique. Et le tournant pris par le récit n’est pas complètement ridicule, dans son propre paradigme. Donc disons que c’est vieux, mais pas trop mal quand même. J’en aurais peut-être pris une novella complète histoire de creuser l’idée à fond. Avec assez de soin, j’aurais pu passer au delà du concept lui-même pour aller creuser uniquement dans la proposition plus anthropologique. Si j’ose dire.
Forêt d’absence, Alex Vicq
Meh. Faisant difficilement abstraction de saillies misogyne assez immondes en milieu de récit qui n’y ajoutent rien et le salissent stupidement, j’aurais pu croire à une nouvelle fantastique un peu trop cryptique à mon goût, mais pas dénuée d’intérêt pour autant. Malheureusement, cette histoire de jeune couple isolé dans une forêt changeante dont l’environnement et les souvenirs ne cessent de changer dans un enchainement confus ne semble pas savoir elle-même ce que son allégorie devrait signifier. De fait, la chute vient donner un contrepoint matérialiste et abrupt qui vient complètement renverser tout ce que la nouvelle avait jusque là essayé de bâtir, et rend l’ensemble encore plus étrange, voire difficilement compréhensible. Pas fameux.
Le merveilleux poste d’essence de Patagonie, Brian Aldiss
*Soupir*
L’effort formel d’une pièce de théâtre en trois fois un acte est à saluer. Voilà.
Après, on est dans de l’absurde conceptuel à la Ionesco, ce qui serait plutôt mon truc, si ce n’était pas si dense et foutraque ; c’est un genre très difficile à équilibrer pour, à la fois, parvenir à raconter un n’importe quoi assez rigolo pour être accrocheur, mais aussi assez évocateur pour provoquer une certaine réflexion par échos parallèles, et surtout, raccrocher tous les wagons pour ne pas perdre complètement les gens. Et là, bon, j’ai ressenti quelques moments de compréhension plaisants, mais l’essentiel était juste… là. Et puis bon sang, peu importe la période ou le contexte, vraiment cette obsession de certains auteurs de toujours tout ramener au sexe et aux femmes, bordel, c’est d’un pénible. Ça parasite tout. Alors voilà, c’était pas si pire, mais c’était pas un régal du tout pour autant. *Haussement d’épaules*.
Cryosculpture, Robert Wissner
Excellent ! On part d’un concept original : deux hommes, employés d’une entreprise de cryogénisation, enfermés pendant un an dans le centre destiné au stockage et au traitement des corps en suspension. Notre protagoniste écrit leur histoire sur le dos des reçus, son compagnon fait des sculptures avec les clients. Oui oui. (*wink* au copain le Chroniqueur, ça faisait longtemps).
Et en creux, tranquillement, sans forcer ses effets, dans un flux d’humour noir parfaitement dosé, l’auteur nous fait cadeau d’une petite œuvre d’anticipation lucide et froide très réussie : je suis moi-même très rigolo. Impeccable de bout en bout.
Qui fut le premier Oscar à recevoir un nègre ?, Craig Strete
Au bout de 5 pages (sur 16), je ne comprenais toujours rien, alors j’ai arrêté. Une espèce de tentative de science-fiction grisant la ligne entre sa diégèse et la réalité à coup d’écriture cinématographique, dans le thème comme dans la forme, mais avec des aliens en plus. D’une certaine manière, ça me rappelait mon essai raté avec le Délirium Circus de Pierre Pelot, mais en encore plus expérimental et démantibulé. Aucun regret, c’était n’imp’.
(Et puis pardon, mais je n’avais pas hâte de comprendre le pourquoi du titre, non plus.)
Qui sème le temps récolte la tempête, Joëlle Wintrebert
Hm.
Travail singulier sur un thème éculé. Un point de vue unique sur une des tartes à la crème de l’Imaginaire : l’immortalité. Je ne peux pas honnêtement dire que j’apprécie particulièrement le style très lyrique et parfois verbeux de Joëlle Wintrebert, mais je dois aussi bien admettre que le revers de cette médaille c’est un traitement ciselé et exprimant une voix que je n’ai jamais vraiment entendu jusque là. C’est sans doute un peu trop pour moi, qui ai tendance à trouver une telle abondance de figures rhétoriques assez indigeste, boursouflant le cœur du récit et des idées qu’elles couvrent. Mais en même temps, ici, ça joue un peu sur le tableau du cryptique d’une manière assez bien foutue. Sous quelques envolées se cachent les clés du mystère narratif, et ça marche pas si mal, si on daigne jouer le jeu. Alors je l’ai fait. Un peu à mon corps défendant, parce qu’on ne se refait pas, mais au final, on a quand même une approche thématique qui me parle ; un regard avec lequel je peux suffisamment m’aligner pour lâcher une moue satisfaite une fois arrivé au bout du chemin. Ok.
Le triomphe de la grande révolution verte en Amérique : Rapport périodique, Murray Yaco
Dans l’idée, c’est un texte satirique tout ce qu’il y a de plus rigolo et sympathique, se proposant de nous présenter les avancées biologiques futures après l’arrivée au pouvoir d’un président spécialiste du sujet, afin de lutter contre la ruine écologique. Le problème, c’est qu’en dépit d’un certain effort créatif, à chaque nouvelle séquence, c’est la même structure de blague qui est utilisée : un problème – une solution élaborée mais pas assez réfléchie – un nouveau problème résultant de la solution. Donc c’est amusant, mais terriblement redondant, et surtout un peu trop cynique et absurdement bête pour mon goût. Pas scandaleux ou quoi, juste… Bleh.
Et fin des textes de fiction, place au reste du numéro.
Et quelle introduction pour la petite séquence dessinée qui s’en suit, titrée Botania-pyschose, de Jean-Paul Martinez.
En substance, Yves Frémion – le cuistre de l’intro de mon intro – y explique que franchement, chez Univers, on est pas comme les autres cons (sic) qui font des anthologies qui se vendent avec des noms connus sans aller y chercher plus loin. Que oui, bon, on va chercher des Caza, des Foss ou des Bilal, mais des fois aussi, on tente des inconnus totaux qui font des trucs pas mal du tout (sic encore), même s’ils ont des petits trucs à améliorer çà et là (re-re-sic). Quelle classe folle, décidemment.
Malheureusement, j’ai plus à dire sur l’intro que sur l’art dont il est question, parce que bon… 6 planches en monochrome qui racontent à peine une courte histoire, forcément, je manque de munitions pour en dire quoi que ce soit de vraiment passionnant. C’est joli, voilà. Désolé.
Espérons qu’on aura plus de chance avec notre premier petit article non-fictionnel : Le cinéma de science-fiction depuis 2001, par Pierre Giuliani. Prometteur, comme titre !
Et c’est… un peu décevant. Le fonds du propos n’est pas mauvais, en soi, confrontant le paysage de la SF à son héritage et ses ambitions, au travers, donc, de son rapport direct avec un film de Stanley Kubrick qu’il ne sert plus à rien de présenter, tant son impact sur son petit monde a été massif. Le problème, c’est que je trouve que l’auteur fait beaucoup de circonvolution assez creuse après avoir effectué son premier constat, et sans doute le plus utile : il y a dans le cinéma de SF, un avant et un après 2001. Il fait à sa façon le constat que beaucoup ont déjà fait à propos de Tolkien en fantasy littéraire : dès lors qu’on arpente le même genre que ce titan, dans un médium où dans l’autre, on doit en première intention le choix de l’inclure ou non dans nos plans. Tout en sachant que peu importe le choix effectué, de toute manière, la présence ou l’absence dudit titan sera remarquée, et tous les jugements subséquents seront faits en fonction de ce choix, et donc de sa réussite. Et si c’est vrai, je trouve que ça ne va pas bien plus loin. Ou en tout cas, arrivé au bout du texte, je n’étais pas bien sûr d’en avoir retenu grand chose d’autre. Et je jure que j’ai fait de mon mieux pour être attentif.
Disons avec plus de diplomatie que j’espérais un éclairage plus marqué par son époque, comme j’ai pu en avoir quelques uns auparavant dans mes explorations. Pas forcément une épiphanie, mais juste une réflexion propre à une période révolue, qui aurait pu me donner des éléments à me mettre sous la dent, à mettre en contraste avec les certitudes propres à mon temps et mon lieu. Et force est de constater qu’en dépit du temps passé ; nous n’avons pas bien plus avancé que l’auteur de cet article, finalement. Ce n’est pas forcément lui qui est à blâmer, ici, mais peut-être la SF en elle-même, en tant qu’entité collective ; ou plus généreusement, sa place dans une culture générale qui ne lui a toujours pas accordé plus de crédit et d’espace d’expression pour se réinventer et aller au delà de ses propres classiques. Je ne saurais dire. Je suis juste un peu triste, finalement, de voir que notre passion commune n’a apparemment pas su, en 50 ans, réussi à porter un regard un peu neuf sur elle-même. Peut-être sommes nous encore trop jeunes.
Dur.
Ensuite, Daniel Riche nous livre Galouye, le mystique grimaçant, une chronique portant sur Daniel Francis Galouye, auteur américain décédé en 1976.
Et bon. C’est léger. On nous dit en substance que l’homme était plus adepte de la qualité que de la quantité, aux contraires d’autres collègues plus connus que lui, et que c’est sans doute pour ça qu’on a peu parlé de lui. Les autres collègues en question apprécieront. Et puis derrière, on le compare à Dick, beaucoup, et on aligne quelques poncifs autour de l’idée que Galouye offrait plus de questions que de réponses dans son travail, et que l’énigme qu’il constituait était morte avec lui. Je ressors un peu curieux de le croiser un jour, mais je ne suis pas enthousiaste non plus. Ça manquait de profondeur dans le traitement.
Et pour finir, François Rivière nous offre Raymond Roussel et la fiction spéculative.
Le Raymond du titre est selon l’auteur de cette chronique, la plus grande énigme littéraire depuis Shakespeare. Rien que ça. Va falloir me convaincre.
Et je n’ai pas été convaincu. Principalement parce que je n’ai pas compris grand chose, en dehors du fait que ce Raymond Roussel avait l’air d’être un pionnier d’un genre littéraire auquel lui seul excellait le temps de sa vie. On me cite Robbe-Grillet et Ballard, et alors peut-être que je comprends mieux, on me parle de forme et de poésie comptant plus que le fonds, et je comprends encore mieux. Je crois que cette chronique était à l’image de ce dont elle parlait. Et de fait, ce n’était pas clair ; je ne suis pas câblé comme ça. C’est toujours ça de pris pour ma culture G, au moins.
Bien bien bien… J’ai appris des choses, en lisant ce numéro, c’est cool. Mais force est de constater qu’en dehors de quelques textes, je ne me suis pas régalé. Alors soit je n’ai pas de chance, soit je vais commencer à me dire que si Fiction a duré bien plus longtemps que Univers, ce n’est sans doute pas un hasard. Alors certes, ce ne sont pas les mêmes revues, les mêmes ambitions, sans doute pas les mêmes moyens, mais surtout, j’ai l’impression que ce n’étaient pas les mêmes équipes ni la même approche. À ce stade, j’ai le sentiment lancinant qu’Univers manquait du soin de son cousin, et surtout d’élégance. Beaucoup de piques dans les propos éditoriaux, de propos très moyens, et d’usages péjoratifs de certaines références afin d’en complimenter d’autres par bête effet de contraste ; une pratique que je trouve personnellement très mesquine, parce qu’elle mène surtout à enterrer la première plus qu’à élever la seconde. Et oui, j’ai bien conscience de l’ironie de présenter les choses comme ça. Mais n’empêche que c’est la première fois que je lis un responsable de la rédaction faire preuve d’autant de dédain si assumé envers tant de gens, et de façon si gratuite.
Mais peu importe. L’exploration du passé demeure éducative. Alors on ne va pas s’arrêter de sitôt.
À la prochaine fois, donc !
Au plaisir de vous recroiser.
En attendant, que votre avenir soit rempli d’étoiles. 😉

Merci pour le clin d’œil ! Intéressant que tu te plonges dans ces revues 🙂 .
J’aimeAimé par 1 personne
Toujours un plaisir ! ❤
J’aimeAimé par 1 personne