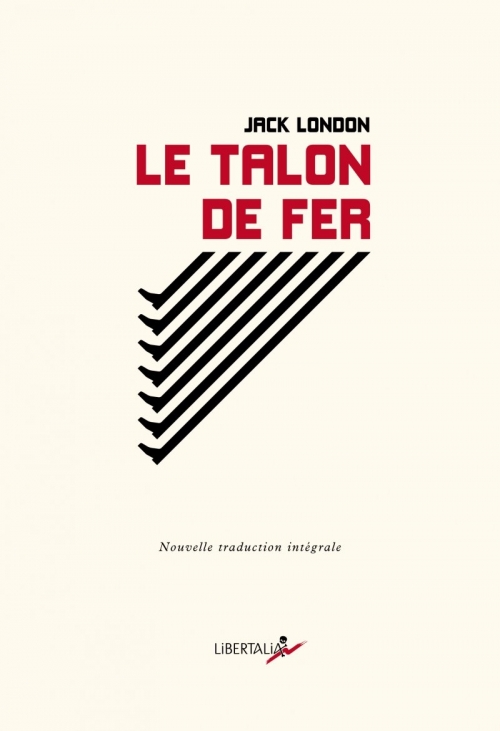
Re-Education (Through Labor) – Rise Against (extrait de l’album Appeal to Reason)
Comme j’aime désormais à le dire, je ne crois pas tant aux signes qu’à la nécessité de donner du sens aux coïncidences.
Il y a quelques mois, lors d’une de mes désormais régulières explorations d’une vieille revue, plus précisément le n°168 de Fiction, j’ai croisé une chronique enthousiaste d’un roman dont je n’avais jamais entendu parler auparavant, mais dont l’auteur, Gérard Klein, disait autant de bien que de choses assez captivantes pour me convaincre qu’il y avait là quelque chose à creuser. Or, il y a deux semaines, au hasard d’un bienheureux reboost de la merveilleuse Hélène Collon sur Mastodon, j’ai appris que la maison d’édition Libertalia en était à sa sixième réimpression de l’ouvrage en question ; celui qui nous concerne aujourd’hui, vous l’aurez compris.
Je n’ai évidemment pas pu résister à ma curiosité, pas plus qu’à mon envie, et je me suis vite fendu d’un mail pour leur demander, bien fiévreusement et non moins cavalièrement, s’il était possible de me faire profiter d’un SP de l’ouvrage.
Si nous sommes là aujourd’hui, c’est parce qu’ils ont généreusement accepté, et que je ne me suis pas fait prier pour me précipiter et découvrir de quoi il retournait exactement.
Ce dont il retourne, c’est, pour respecter ce qui est désormais une étrange coutume sur ce blog, une énorme baffe littéraire. Assortie de tout plein de petites baffes de plein de sortes différentes. Un immense plaisir, donc.
Même si, je ne vais pas vous mentir ; comme souvent dans ces cas-là, la chronique va être une tannée à écrire.
Mais le jeu en vaut la chandelle, alors ne perdons plus de temps.
C’est le concept central de ce roman qui m’avait le premier alléché : ne connaissant Jack London que comme journaliste et écrivain porté sur la nature, son image étriquée par la légende qu’est Croc Blanc et une culture très limitée de son travail, j’ai été immensément surpris d’apprendre qu’il était un fervent socialiste, et surtout, dans le cas qui nous concerne présentement, un auteur de science-fiction, ayant commis Le Talon de Fer en 1908.
Et rien que formellement, London s’affirme immédiatement comme un créatif audacieux, puisque cet ouvrage adopte le format singulier de la méta-littérature : c’est un récit fictif enchâssé dans un contexte fictif qui le contient. Comme nous l’annonce directement l’avant-propos intra-diégétique du roman, nous y suivons Avis Everhard, épouse du révolutionnaire Ernest Everhard, narrant sa vie commune avec celui qu’on devine être une figure historique importante ayant lutté contre l’Oligarchie tyrannique connue sous le nom de Talon de Fer. Cependant, le récit en question est mis en lumière par les presque 700 ans qui le séparent de sa découverte par La Fraternité des Hommes, organisation civilisationnelle ayant historiquement fait suite à cette oligarchie, une fois enfin vaincue.
Nous avons donc droit à une sorte de journal intime romancé uchronique, extrêmement chargé politiquement et socialement, annoté par une succession de notes de bas de page signée par un observateur tiers du futur nous donnant des précisions sur une perspective tronquée ou insuffisante ancrée dans la digression temporelle imaginée par Jack London.
Et si ce n’était que ça, pour 1908, ce serait déjà assez impressionnant, en l’état. Pour ne pas dire, sincèrement, assez génial.
Alors, certes, on est pas dans le sense of wonder ou l’invention conceptuello-technologique massive comme la science-fiction la plus répandue ; on est plutôt dans la SF ou le S veut dire « sciences humaines ». Ici, plus particulièrement, la politique et la sociologie. Et soyons honnêtes, ce roman ne brille pas particulièrement non plus par son sens de l’intrigue. On peut même dire qu’il s’en fout un peu, et qu’il fait plutôt office de pamphlet socialiste se servant de la fiction comme d’un vecteur d’illustration. Mais comme c’est fait de façon assez transparente et honnête, et que Ernest Everhard est frontalement un author’s pet servant de faire-valoir à Jack London au travers des yeux de sa femme profondément énamourée, je trouve que ça passe plutôt très bien, en dépit, voire même grâce à son choix de nous exposer dès le début du texte l’échec des perspectives révolutionnaires de ses personnages ; il n’est pas question de la finalité de la machine, mais du fonctionnement de ses rouages.
On est dans le cas rare mais merveilleux où la distance temporelle donne encore plus de poids au fonds du récit ; où il prend, à chaque réussite analytique ou prédictive, une valeur prophétique encore plus exceptionnelle. Et si vous me suivez sur Bluesky, vous savez déjà que je n’ai pas pu m’empêcher de partager certains des passages les plus terrifiants d’acuité signés Jack London, où, par l’entremise d’Ernest Everhard ou de certaines notes de bas de page, il décrit par le menu, et sans aucune erreur factuelle, le fonctionnement de la machine capitaliste oligarchique. Plus de 100 ans de décalage, et pas une seule de ses diatribes gonflées aux stéroïdes socialo-marxistes ne me semble commettre la moindre erreur d’analyse sur les motivations idéologiques des capitaines d’industrie et de leurs laquais, pas plus que sur les conséquences que leur modèle de production fait peser sur les épaules de la classe laborieuse.
Certes, on retrouve dans une partie du récit le même relatif défaut que dans Les Dépossedés, c’est à dire des échanges et des mises en situation dictées par la nécessité de faire dire aux personnages ce que l’auteur voulait leur faire dire, renonçant assez clairement à un flot plus organique de l’histoire qu’ils vivent au profit d’une démonstration claire et didactique, mais pour une raison que j’ai mis du temps à identifier, je trouve que ça marche beaucoup mieux ici. Et cette raison, c’est sans doute que Le Talon de Fer est nettement plus enragé, et que la passion socialiste de Jack London profite beaucoup plus à son roman que la distance critique et théorique d’Ursula Le Guin. Là où cette dernière disserte sans cesse et met en question ses propres interrogations sans toujours pouvoir ou vouloir y trouver une réponse définitive, sans doute empreinte d’une certaine culture universitaire et scientifique, ce qui donne à son texte la gravité qui lui convient, et en fait sans conteste un grand texte, mais qui m’a un peu laissé sur ma faim ; Jack London, lui, est à mes yeux là pour casser des bouches. Métaphoriquement, certes, mais ça se joue à pas grand chose.
Alors certes, on peut effectivement, et on doit, prendre un recul nécessaire sur la perspective très hétéronormée et un brin phallocrate du texte, avec cette narratrice d’abord spectatrice des débats passionnés systématiquement remportés par son mari-qu’il-est-trop-beau-qu’il-est-trop-fort, heureuse bénéficiaire des largesses du système, sauvée de son oisiveté bourgeoise coupable par la seule force de persuasion de son héros, ne prenant réellement part à l’action que lorsque ce dernier est éloigné d’elle et qu’elle ne peut plus être sa secrétaire. Tout comme on doit, en dépit du timide positionnement anti-colonial et anti-esclavagisme de London, prendre en compte sa perspective très blanche et en quelque sorte monosectionnelle, pour admettre que le texte, en dépit de ses qualités prophétiques sur le plan politique, appartient quand même en plein à son époque, et qu’il doit être pris, par moments, avec quelques pincettes.
À cet égard, je pense que le moment est bien choisi pour saluer le formidable travail des éditions Libertalia, qui en plus de leur excellente nouvelle traduction, ont fait le choix d’adjoindre aux notes de bas de page intra-diégétiques quelques précisions de leur fait, afin de bien contextualiser le texte de London. Déjà parce que c’est bien de faire le travail aussi honnêtement et jusqu’au bout, clarifiant des points forcément un peu obscurs de l’uchronie imaginée par l’auteur, très ancrée dans sa réalité matérielle, mais aussi et parce que par simple effet de contraste, les quelques erreurs qu’il commet avivent encore la pertinence de tout ce qu’il raconte de juste, fictivement ou non.
Alors certes, si on n’adhère pas à l’idéologie socialiste et qu’on est un fervent partisan du capitalisme, ça va être compliqué d’apprécier le travail de Jack London dans cet ouvrage. Heureusement, j’ai plutôt tendance à être d’accord avec l’immense majorité des arguments qu’il avance au travers de son personnage principal. Mais le texte, je trouve, va plus loin, en étant malgré tout une œuvre purement littéraire assez solide ; il compense très habilement ses sacrifices en intrigue par un effort constant et extrêmement convaincant sur son world-building. Au delà des éléments factuels les plus parlants sur l’époque de rédaction du roman dont Jack London s’inspire évidemment pour sa prospective la plus immédiate, et sans doute la plus frontalement percutante – genre la prédiction de la 1ere Guerre Mondiale et d’une partie de ses motivations, allo ?! – il parvient à glisser aussi subtilement qu’élégamment des éléments sur la nature et le fonctionnement de la tyrannie.
Puisqu’en dépit de la puissance affichée de l’utopie socialiste du future depuis laquelle nous sommes censé·e·s recevoir le texte d’Avis Everhard, elle n’est pas en mesure de nous fournir tous les éléments que la narratrice manque à nous fournir elle-même ou que la Fraternité des Hommes est incapable d’expliquer. Certains révolutionnaires qu’Everhard cite, et qui semblent pourtant avoir de l’envergure, ont disparu des archives ; certains criminels au service du Talon de Fer ne sont identifiés que bien longtemps après les faits au hasard d’une découverte fortuite : Jack London fait la démonstration en creux de l’immense puissance d’une Oligarchie coordonnée et organisée, qui peut littéralement effacer notre mémoire collective, effacer l’existence des gens en plus de toutes ses capacités matérielles.
Cette Oligarchie n’est, en dehors de quelques noms immatériels et d’industries désincarnées, rien d’autre qu’une ombre sournoise planant sur l’entièreté du récit, un fantôme contre lequel on ne peut se battre qu’en lui volant ses propres armes, en trichant dans le paradigme du jeu qu’il a édicté, en espérant un sursaut de la part de ceux que ce fantôme est parvenu à soumettre, endormir ou subjuguer. Ce roman est aussi fascinant pour ce qu’il dit que ce qu’il ne dit pas, mais réussit quand même à mettre en évidence pour qui voudra bien le lire. Je ne saurais que trop vous recommander de le faire.
Sans doute ai-je avant tout été soufflé parce qu’en dépit de son âge, ce texte est aussi actuel que jamais. Si son époque est bien la sienne, ses constats et ses arguments sont intemporels et frappent par leur justesse et l’efficacité de leur articulation. Jack London, ici, met son savoir-faire journalistique au service de sa rage et nous livre un roman d’une férocité, d’une lucidité absolument inégalables, tout en se permettant, au passage de pondre un roman de SF formellement innovant et sans aucun doute pionnier à biens des égards. Certes, sa colère est centenaire, mais son espoir aussi.
Je pense qu’il faut conserver et chérir les deux.
Merci Fiction, merci Gérard Klein, merci Hélène Collon, merci les éditions Libertalia, merci le destin. Et Jack London, aussi, évidemment.
Au plaisir de vous recroiser.
En attendant, que votre avenir soit rempli d’étoiles. 😉
