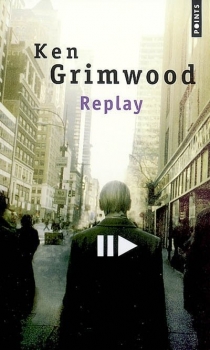
Swallowed – Dresscode
Quand Pierre-Paul Durastanti parle, on l’écoute. C’est un principe auquel je crois très fort depuis des années maintenant, et s’il n’était pas déjà clair que je vouais à ce cher monsieur une admiration et une affection sans bornes depuis ma découverte émue de Demain les chiens, au delà de nos ponctuels mais toujours plaisants rapports humains virtuels, que ce soit dit aujourd’hui. Parce que non seulement le sieur Durastanti est un traducteur de talent, c’est aussi et surtout une précieuse personne dont la culture littéraire et les goûts sont sûr·e·s.
Et donc, quand je le lis dire que le livre qui nous concerne aujourd’hui est un de ses cadeaux livresques favoris, je n’hésite pas une seule seconde, je le note dans un coin de ma tête pour acquisition ultérieure. Puis, l’acquisition ayant été faite il y a quelques semaines, il n’aura fallu que peu de temps pour que je me décide à passer à l’acte.
Et nous voici, pour parler du résultat.
Replay est un ouvrage dense et riche, qui aura provoqué en moi tout un tas d’émotions et de réflexions aussi paradoxales que contradictoires, dont ressort néanmoins, finalement un enthousiasme rare et sincère. J’ai aimé ce bouquin, parce que j’y ai trouvé des choses à penser et à dire. Et j’ai très envie de vous en parler.
Alors c’est ce qu’on va faire.
Jeff Winston est un type lambda. Une carrière correcte mais pas flamboyante, un couple durable mais pas forcément très solide, une vie plus médiocre que mauvaise. Soudain, un soir de 1988, il meurt. Pour se réveiller dans son corps, 25 ans auparavant, alors qu’il a 18 ans, avec tous ses souvenirs. Après une évidente et terrifiante incompréhension, il voit dans cette anomalie une opportunité unique de tout reprendre à zéro, qu’il va saisir à bras le corps.
Comme j’aime à le dire, sans la moindre originalité, mais avec conviction : c’est pas tant l’idée de base qui compte, mais bien sa réalisation. Que la boucle temporelle – oui parce que spoiler mineur, on est sur de la boucle temporelle – fasse 25 ans, un jour, 2 semaines ou 2 heures, ça ne compte pas vraiment, pas plus que la résolution de ladite boucle ; vous pouvez mettre n’importe quel bon sentiment ou macguffin au cœur de la résolution de votre intrigue dès lors qu’elle implique de la manipulation temporelle, l’essentiel est ailleurs.
Et ici, l’essentiel, je crois que c’est l’approche extrêmement pragmatique et matérialiste de l’auteur. Ce roman n’est pas à proprement parler spectaculaire, il économise beaucoup ses effets ; et surtout, il a l’immense intelligence, je trouve, de rester toujours à la hauteur de son protagoniste, d’une façon très sensible. On suit Jeff Winston dans ses réussites comme ses échecs, ses triomphes et errements les plus discutables : puisqu’humain, il passe par toutes les étapes possible d’une vie, avec tout ce que cela peut suggérer de magnifique ou de terne.
Ce qui m’amène à ma première réflexion d’importance. Si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que j’entretiens une relation complexe avec Jo Walton et son Mes vrais enfants. Pour être honnête, ce qui a commencé comme une simple absence d’appréciation pour ce roman de ma part est devenu au fil des années et des discussions tentant de me faire comprendre l’attrait singulier de ce récit ce qui s’apparente presque à de la détestation. Je ne saurais dire si c’est la simple frustration de ne pas comprendre ce qui a ému tant de gens dans ce bouquin, ou au contraire de trop bien le comprendre sans pouvoir moi-même y adhérer, mais n’empêche que plus j’entends des compliments à son propos, plus mes dents grincent. Il y a quelque chose dans la façon qu’a Jo Walton de raconter son histoire qui agresse ma sensibilité dans des proportions qui m’échappent encore trop pour que je parvienne à verbaliser la chose correctement, et ça ne fait qu’ajouter à mon agacement à son propos. Un côté « trop beau pour être vrai », une inexorabilité du happy end qui me donne l’impression tenace que ce roman est malhonnête, d’une certaine manière : et j’ai beau savoir que ce n’est pas vraiment ça, il n’empêche que ça me reste comme une dent creuse qu’on ne peut s’empêcher de titiller du bout de la langue en dépit de la douleur.
Et en constatant le plaisir que j’avais à lire Replay tout en me rendant compte qu’une grande partie de la démarche thématique suivie par Ken Grinwood était basiquement la même que celle de Jo Walton, il a bien fallu que je m’interroge encore sur la différence fondamentale qu’il devait bien y avoir entre les deux pour que mon ressenti soit si clairement clivé. Pourquoi, en dépit d’une morale générale globalement similaire entre ces deux ouvrages, une vibe positiviste et parfois doucereusement optimiste, de même qu’une conclusion un peu à l’eau de rose, pour ne pas dire un brin gnangnan, dans Replay, j’ai le sentiment d’avoir à ce point trouvé mon compte sans me sentir floué ?
Mon premier élan serait de revenir sur une obsession personnelle, une explication que je donne très/trop souvent, par confort et facilité, à savoir l’acceptation du trauma et la persistance de ce dernier. L’idée, c’est que j’aime beaucoup quand un bouquin me raconte des choses aussi belles que tragiques, mais que le beau n’efface pas les angoisses liées à des mauvais souvenirs ; qu’il ne suffit pas de dépasser le trauma pour le faire disparaître complètement, qu’il en restera toujours une ombre. C’est un reproche que je fais assez volontiers à Mes vrais enfants ou à Vers les étoiles, que je ne peux pas ne pas citer ici aussi à cet égard : je n’aime pas ces récits dont j’ai le sentiment qu’ils ne sont écrits qu’avec leur conclusion en tête, et que le parcours n’en est finalement que l’accessoire. Dans ces histoires, j’ai trop souvent l’impression que les obstacles placés devant les protagonistes n’en sont que le temps d’être battus en brèche, et qu’ils n’ont plus aucune consistance dans la suite du récit une fois dépassés. On n’en parle plus ou presque pas, à peine comme des trophées, des jalons incorporels dans une quête plus générale dont la seule conclusion est réellement importante. Or, je crois très fort à l’idée que le trajet compte plus que la destination, surtout quand il s’agit de raconter des histoires, donc forcément, quand la fin comme objectif premier me semble écraser le reste du récit, y a un truc qui coince.
Mais ce premier élan me semble incorrect, ou du moins insuffisant, pour justifier le plaisir que j’ai eu à lire ce roman. Déjà parce que Ken Grimwood, si je suis dois être honnête, tombe un peu lui-même dans ces travers. Nettement moins, mais un peu quand même. Il laisse somme toute plus de places aux échecs et à leurs conséquences durables dans la psychologie de ses personnages à mes yeux, de même que sa conclusion me semble plus ouverte, mais force est de constater que l’ambiance générale tient là aussi plus du conte merveilleux que de la hard-sf ; l’argument science fictif est un prétexte plus qu’une fin en soi. Ce qui n’est absolument pas un problème soit dit en passant, mais ça explique sans doute pourquoi je ne peux pas m’empêcher de dresser une comparaison systématique entre ces textes à la rédaction de cette chronique : les ponts narratifs et thématiques me semblent trop nombreux pour être ignorés. Et de toute manière, ces parallèles sont trop prégnants dans mon esprit pour que j’en fasse abstraction ici, le contraire me paraitrait malhonnête.
Alors c’est quoi, la foncière et définitive différence qui me fait apprécier ce roman beaucoup plus que les deux autres, en dépit de tous les signes de similarité que mon désir d’honnêteté intellectuelle me fait invariablement déceler ? Peut-être avant tout ce pragmatisme que j’évoquais plus haut ; le fait que Ken Grimwood laisse la place à son protagoniste pour échouer et être un peu minable, parfois, qu’il puisse être au moins ponctuellement le responsable premier des évènements les plus complexes ou douloureux qui lui arrivent. Sans doute aussi le fait qu’il ménage de l’espace à des idées science fictives assez sympas autour de l’uchronie et de l’importance qu’une seule personne peut avoir à l’échelle d’un pays ou du monde, même si ce n’est que très marginal à l’aune du récit entier. J’aime à penser que c’est assez raccord avec la trajectoire et l’intention du roman lui-même, ceci étant dit ; Jeff Winston est quelqu’un d’ordinaire, il est assez logique que ses histoires le demeurent également, en dépit de ce que sa situation peut avoir d’extraordinaire.
Alors c’est peut-être ça, finalement : Replay fait les choses avec beaucoup de simplicité. Il ne pousse rien trop loin, et dès que son intrigue pourrait patiner ou tourner en rond, nous faire nous interroger sur certains de ses creux ou étranges zones d’ombres, Ken Grimwood change de braquet, tranquillement, sans forcer, et nous amène dans un terrain nouveau en compagnie de Jeff Winston. Et de fait, on a jamais le temps de s’ennuyer, et pour peu qu’on ressente la moindre empathie envers le héros de cette histoire, les pages tournent toutes seules. On veut savoir ce qui va arriver, on prend plaisir à suivre les trajectoires de cet homme ordinaire dont les atermoiements et épreuves sont les nôtres, autant de reflets de miroirs avec seulement quelques subtiles variations de lumière. Pour une fois, une rare fois, l’empathie a été simple pour moi, c’est sans doute pour ça qu’elle m’est aussi précieuse, et que j’ai du mal à réellement saisir la singularité du récit dont j’essaie de vous parler.
Si je devais, tant bien que mal, essayer de résumer avec concision les raisons de mon appréciation du travail de Ken Grimwood avec ce roman, ce serait avec un aphorisme que j’affectionne, autant pour ses bons sentiments qu’en dépit de son côté un peu fleur bleue. Un adage que j’aime pas tant parce que j’y crois profondément, que parce que je trouve beau et rassurant d’y croire : « ne pleure pas parce que c’est fini, souris parce que c’est arrivé ». Et quand bien même je trouve que la fin de ce roman est peut-être un poil trop dégoulinante de bons sentiments, son auteur est parvenu, par le chemin qu’il m’a fait parcourir, à m’y faire croire pendant quelques secondes, avant que le cynisme fataliste qui souvent m’habite à mon corps défendant reprenne les rênes des mes émotions. Si je ne crois qu’à moitié à l’idée que la vie est une somme infinie de possibles dans lesquels il nous appartient de choir, étant plus Spinoziste que Cartésien, Ken Grimwood, ici, a clairement su donner de la force à la moitié la plus optimiste de mon esprit. Des fois, les bons sentiments, bien exprimés, sont contagieux. Et j’avoue sans peine que ça vaut mieux que l’inverse.
C’est un beau roman, c’est une belle histoire. Le genre de doux-amer cotonneux dans lequel il fait bon se lover de temps en temps.
Au plaisir de vous recroiser.
En attendant, que votre avenir soit rempli d’étoiles. 😉

Un autre roman à conseiller largement dans les rayons Littérature générale — et même au rayon Shakespeare — pour amener d’autres personnes à l’Imaginaire : ´l’Échange´ d’Alan Brennert, qui est accessoirement un de nos romans préférés avec ´Replay´.
Merci pour ce syndrome, que nous lisons assidûment.
J’aimeAimé par 1 personne
Ah bah mince alors, ça me fait quelque chose, venant de vous ; sacré compliment, merci !
Et merci également pour le conseil, évidemment, qui part immédiatement en wishlist.
J’aimeJ’aime