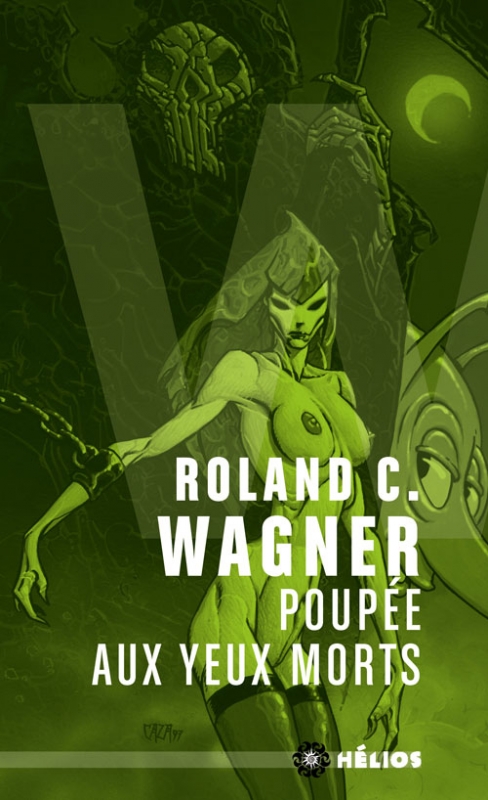
The Hard Part – The Blue Stones (extrait de l’album Black Holes)
Le problème, quand on établit des plans, c’est que des fois on s’y tient trop bien. J’en ai lu et relu, du Roland C. Wagner, pour le bénéfice de ce blog, ne fut-ce que pour encore une fois pouvoir dire tout le bien qu’il faut dire – et redire – de Rêves de Gloire. Et puis un jour, je me suis dit qu’un jour, je relirais aussi tous les Futurs Mystères de Paris, quand le temps aurait assez fait son office pour que leur relecture puisse se faire avec suffisamment de virginité retrouvée ; pour que je puisse en faire une analyse assez poussée pour ne pas risquer l’affreux sentiment de ne pas rendre justice au génie de leur auteur.
Or, en me disant que j’allais attendre un peu pour relire l’une des œuvres majeures d’un de mes auteurs favoris, je l’ai en fait mis en pause tout entier dans mon parcours de lecteur. Dites vous que ma dernière lecture d’un ouvrage signé de sa plume, c’était en Octobre 2023 (!!), avec le merveilleux Chant du Cosmos. Scandale en sandales. Ça ne va pas du tout, cette histoire.
Et puis Scintillements. La figure du fort regretté Ayerdhal aurait pu à elle seule, par évocation, aurait pu me remotiver à relire du Roland C. Wagner, tant les parallèles entre les deux auteurs me semblent se tracer d’eux-mêmes ; mais bien entendu, c’est surtout la lecture du mirifique RCW qui m’a mis un métaphorique et puissant coup de pied au derrière. Il était temps de m’y remettre. Que ce soit avec des découvertes inédites à aller chercher moi-même, ou avec les Futurs Mystères de Paris, qui m’accompagneront pour l’année 2026, à côté des Vorkosigan de Lois McMaster Bujold : parce qu’ici, on sait se faire du bien.
Et donc, pour enfin en arriver au sujet du jour, avec mes excuses pour la digression : Poupée aux Yeux Morts. Dont la lecture a tardé à la fois pour les raisons mesquines citées plus haut, mais aussi parce qu’on m’avait prévenu que ce texte pouvait être compliqué à encaisser dans les mauvaises circonstances. Étant donné que je suis dépressif, j’ai comme qui dirait fait preuve d’une méfiance un tant soit peu excessive, et j’ai un chouïa trainé à rattraper mon retard sur la production de celui qui demeure malgré tout un de mes auteurs favoris de tous les temps.
Bref, bref bref. On y est.
Wah comment c’était trop bien. Et pour plein de raisons différentes. Mais genre plein.
Kerl revient tout juste de la Longue Nuit, un voyage intersidéral de près de 50 ans, pendant lequel, malheureusement, le système de compression temporel n’a pas fonctionné : il a vieilli. Or, le plan était pour lui de retrouver Sue, à son retour, son grand amour, qui avait juré de l’attendre au moment de son départ. Kerl parcourt les rues à sa recherche, encaissant le décalage culturel qui s’est imposé à son monde en même temps que son vieillissement. Et quand il retrouve enfin Sue, c’est pour réaliser qu’elle a été victime d’un conditionnement. Non seulement elle n’a pas vieilli d’un iota, mais en plus elle ne se rappelle plus de rien, et n’est rien d’autre qu’une prostituée de luxe. Une poupée aux yeux morts.
Kerl se décide à tout braver pour la libérer.
Voilà c’est pour le résumé du tout début du texte. Histoire de dire qu’on part de quelque part. Parce qu’en réalité, vouloir résumer l’ambition d’un roman comme celui-là, c’est se résoudre à l’échec ; il y a trop d’éléments pertinents à signaler pour espérer en faire un inventaire exhaustif ou honnête dans le cadre d’une simple recension comme celle que je compte vous proposer. Ce n’est pas que l’histoire d’un homme qui essaie de mentalement et physiquement retrouver sa compagne au sein d’un paysage dystopique à la sauce Wagnerienne. C’est aussi ça, mais ce n’est pas que ça. Parce qu’au fil de tout l’itinéraire qu’emprunte Kerl, on peut aussi, à mes yeux, identifier des histoires dans l’histoires, des thématiques gigognes, des concepts qui s’enchâssent les uns dans les autres pour former un tout cohérent, saisissant de densité et de puissance littéraire.
Pour tout dire, c’est assez compliqué pour moi, pour ne pas dire angoissant, d’essayer d’envisager ce roman comme un ensemble que je pourrais être à même de vous décrire en quelques paragraphes ou quelques traits grossiers, comme j’ai l’habitude de le faire.
Pas parce que Poupée aux Yeux Morts échapperait à une quelconque analyse ou à un regard attentif, non ; pour ce qu’il peut avoir de joyeusement foutraque, comme beaucoup des textes signés de Roland C. Wagner que j’adore, il est tout de même extraordinairement accessible. Mais plutôt parce qu’il propose une expérience tellement fluide et protéiforme, où tout se mélange dans une sorte de réjouissante fuite en avant littéraire, qu’il me paraît compliqué d’en isoler des composants singuliers sans mécaniquement faire l’impasse sur la complémentarité des autres composants qui vont avec.
Par exemple, je pourrais parler de l’ambiance dystopique poisseuse et glauque qui nous accueille dans le roman. Sale atmosphère, avec des images terribles, écrites très crûment. Qui honnêtement, pour du Roland C. Wagner, même en me disant que ça date de la fin des années 80, fait vraiment bizarre, venant de lui. Et qui pour n’importe quel·le auteurice, dénote d’un talent assez éblouissant, notamment par la puissance évocatrice de la narration, ramassée et oralisée, mais ne manquant certainement pas d’un certain style et d’une paradoxale élégance. On est dans le genre de récit qui happe, qui prend les tripes en ne laissant pas à son lectorat la moindre seconde pour reprendre son souffle à moins d’explicitement le vouloir. Pendant quelques dizaines de pages, je l’avoue, j’ai compris l’avertissement ; il fallait pouvoir encaisser l’introduction et l’exposition qui allait avec. Pas qu’elle était mal écrite, ça non ; c’est un péché dans lequel je n’ai jamais surpris Roland C. Wagner, même quand il écrivait pour Jimmy Guieu (oui oui). Mais de fait, c’est quand même bien lourd, bien déprimant, ce début d’intrigue, avec une société qu’on devine, qu’on sent sale et injuste, un monde dans lequel on ne voudrait certainement pas vivre, où l’absurde rime avec l’angoisse.
Et puis doucement, sans s’en donner l’air, le récit change. Je ne saurais même pas identifier l’instant de la bascule, si tant est qu’il y en ait une, pas plus que je ne saurais pointer les jalons de début et de fin d’une quelconque période de ce changement ; mais n’empêche que comme une évidence, l’optimisme Wagnérien reprend la main. Je ne saurais pas le dire mieux ; c’est comme si alors même qu’il avait essayé d’écrire un truc bien affreux, bien déprimant, bien sérieux, le naturel de l’écrivain lui avait tapé sur les doigts avant de rectifier la course. Ça se fait par petites touches, avec quelques blagues et calembours bien nuls mais assumés avec tant de conviction que le rire en devient inévitable, avec des dialogues ciselés, des bouleversements narratifs aux petits oignons, et autant de scènes d’excellence pour aller avec : la bonne humeur suinte de partout et contamine l’ensemble, par capillarité.
Et sans se rendre compte, d’un coup, on se retrouve au cœur d’une révolution politique, culturelle et humaine, dans laquelle cohabitent des aliens aux allures de cartoon, des clones adeptes de la communication par les blagues nulles, des voyageurs du temps fans du Rocky Horror Picture Show – ce qui est très logique, quand on y pense – un cirque, une bande de blousons noirs au goût alternatif de la violence, et tout un tas de personnages secondaires chouettes pour aller avec. Avec en antagoniste un gouvernement et des forces de l’ordre rigoristes et conservateurices dont les échos pourraient être réjouissants d’acuité s’ils n’avaient pas 40 ans d’avance, ou peut-être encore autre chose de moins évident mais de tout aussi pertinent.
Et là je tombe sur un os très personnel. Parce qu’en lisant Poupée aux Yeux Morts avec un immense et quasi ininterrompu plaisir, j’ai dû faire un constat, qui m’a poussé ensuite à me poser une question impossible.
Pour qui, comme moi, a lu Les Futurs Mystères de Paris, il est évident, pour ne pas dire criant, que le présent roman en est le brillant brouillon. Les convergences thématiques et conceptuelles sont bien trop énormes pour être ignorées ; et je rage de ne pouvoir ici les détailler pour quiconque ne connaîtrait pas le travail légendaire de l’auteur et à qui je ne voudrais surtout pas gâcher l’éventuel plaisir. Faites moi juste confiance, au pire : c’est abusé comme on sent tous les éléments majeurs à venir de la grande saga de Roland C. Wagner, juste dans une forme un peu moins raffinée, pas exactement agencés de la même manière. Et si je trouve que le seul (tout petit) défaut de ce présent roman est sa fin un poil rushée et manquant de la substance qui confère sa grandeur au reste du texte, il n’empêche que je me dois de m’interroger.
Est-ce que j’aurais autant aimé ce roman s’il avait dû être parmi les premiers que j’ai lu de lui ?
Une question évidemment impossible, confinant même à l’inutilité et à la masturbation intellectuelle, j’en conviens. Mais n’empêche qu’arrivé à la fin, malgré moi, elle se pose, et je ne peux pas l’ignorer. Est-ce que, s’il avait été question d’un auteur que je ne connais pas, j’aurais accepté les mentions multiples et répétées de poitrines féminines dans une bonne partie de l’ouvrage, et ce en dépit de la relative justification du male gaze au cœur de la narration grâce à son incessant questionnement politico-social de la dystopie Néo-Puritaine ? Aurais-je autant goûté les accès de psychédélisme chers à l’auteur si je n’en avais pas pris l’habitude par ailleurs, et s’ils n’étaient pas devenus, avec le temps, synonymes de sa singulière façon de penser et de son esprit libertaire ? Aurais-je pu pardonner comme je l’ai fait sans trop y penser ses quelques écarts de langage et marques intellectuelles d’une époque heureusement révolue, y compris au milieu de ses scènes les plus marquées de sa farouche volonté d’unité, de paix et de compréhension mutuelle ?
Peut-être, peut-être pas. Toujours est il qu’il est continuellement fascinant pour moi de constater à quel point une relation avec un·e auteurice qu’on aime se construit sur le temps long et d’une manière propre à chaque membre de son lectorat. Là où j’aurais pu éventuellement trouver il y a bien des années encore, plus de preuves de la vieillesse d’esprit d’un auteur mâle cishet blanc de plus que l’inverse dans ce texte, il s’avère que j’ai bien au contraire trouvé une nouvelle brassée de raisons d’adorer Roland C. Wagner comme peu d’autres auteurs avant lui.
Le fait est que face à ma volonté inébranlable de lire un maximum de choses différentes, je dois parfois m’astreindre à quelques lectures dont les concepts sont solides, mais dont la modernité sociale n’est pas vraiment au niveau ; je dois alors faire preuve d’une certaine mansuétude un peu coupable pour les juger sur des critères qui ne m’empêcheraient pas de ne plus être capable de profiter de rien. De fait, ça fait alors du bien de tomber sur des textes, de temps en temps, qui me permettent au contraire de me détendre et de profiter à fonds sans avoir à trop me surveiller. Dans ces cas là, je m’autorise au contraire à être plus sévère, parce que je sais que cielle que je suis en train de lire, face à des critiques de l’acabit de celles que je porte en mon for intérieur à leur encontre, auraient pris le pli. Parce que je sens, peut-être un peu aveuglément, mais avec trop de plaisir et de confiance pour en avoir peur, une réelle confiance s’établir entre moi et ce que je lis.
C’est ça que j’ai ressenti, ici encore. Certes, tout n’est pas parfait, en terme de valeurs ou d’expression desdites valeurs ; mais à la lumière des progrès accomplis entre ce roman et la saga dont il est clairement le progéniteur, je ne peux en aucun cas douter des progrès dont Roland C. Wagner aurait fait preuve par la suite. Et bordel, que ça fait du bien à penser et à verbaliser. Se dire qu’on est fan de quelqu’un et de son travail sans avoir à craindre de s’être jamais trompé à son sujet, c’est précieux, par les temps qui courent.
Et avec tout ça, je me rends compte que j’ai pas dis grand chose sur le roman lui-même. Que dire. C’est à l’image du travail habituel du romancier : une ode à la liberté et à l’amour universel. À la révolte douce par le truchement de communautés solidaires et pugnaces. C’est encore un de ces romans qui lui ressemblent tant à mes yeux désormais. Fourmillant d’idées, de concepts aussi féroces que créatifs, au sein d’une intrigue aussi délirante que solide où c’est à la fois n’importe quoi et pas du tout. Où on se demande en permanence où on va bien pouvoir être emmené·e sans jamais pouvoir s’en douter ni se méfier d’où on est. C’est un trip d’une douceur incroyable qui permet de s’évader tout en restant incroyablement conscient de rester sur place. Les romans de Roland C. Wagner, c’est une paire de lunettes qui permettent de voir où l’avenir se cache dans le présent autour de nous. C’est un tour de force permanent, goguenard et aux yeux pétillants, qui se rit de l’adversité uniquement pour la tourner en ridicule et mieux la combattre, justement parce qu’elle la prend complètement au sérieux.
Littérairement, c’est exceptionnel, mais c’est encore un cran en dessous de son humanité. C’est dire.
J’ai vraiment hâte de pouvoir en redire tout le bien que j’en pense.
Au plaisir de vous recroiser.
En attendant, que votre avenir soit rempli d’étoiles. 😉
