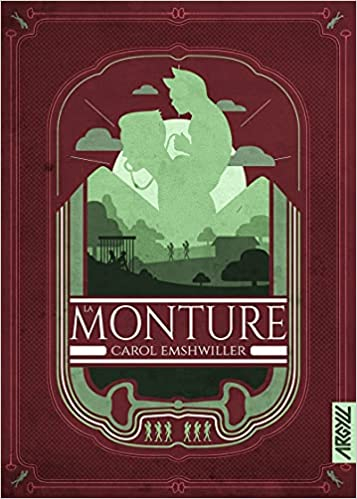
Rejection Role – Soilwork (extrait de l’album Figure Number Five)
S’il y a bien une réalité à laquelle je me heurte plus violemment que d’autres depuis le début de ce blog, c’est bien celle faisant d’un ouvrage littéraire un édifice très fragile. Si fragile, en fait, que je me trouve régulièrement dans un état mental assez détestable ; celui où je vois, comprends et intègre complètement les intentions et qualités d’un récit, sans pour autant pouvoir me débarrasser d’un sentiment contradictoire d’indifférence ou même – dans les pires cas – de dégoût face aux efforts déployés.
Et aujourd’hui, il est bien question de rendre compte encore une fois d’un roman qui m’a mis précisément dans cet état, état que je supporte d’autant moins qu’il met en lumière des contradictions personnelles qui ont le don de m’agacer avant, pendant, et après mes lectures. Parce que si je plaide souvent pour et recherche toujours des récits cohérents entre leurs ambitions et leurs exécutions, une certaine dose de déconstruction des conventions narratives le plus largement établies et une volonté de sous-texte politique et/ou social, malgré mes souhaits, je me trouve trop régulièrement à ne pas aimer des textes qui font précisément l’un, l’autre ou l’ensemble. Et ce paradoxe me gonfle. Parce que c’est pas cohérent, et que j’ai une obsession pour la cohérence, surtout à mon endroit.
Pour le texte qui nous intéresse aujourd’hui, je me suis justement retrouvé à ne pas aimer ce que je lisais, tout en sachant que ça n’aurait pas autant dû me déplaire. Et de fait, mes incohérences et contradictions pas encore totalement dénouées me déplaisent encore plus, faute de nuances que je n’ai pas encore complètement identifiées, qui m’auraient permis de savoir quel est vraiment le problème. Dans des cas comme celui-là, je finis autant énervé contre moi-même que contre l’objet de ma lecture, une sorte de mise en abyme malsaine de rages nébuleuses et irrationnelles. Ou tout du moins pas encore (assez) rationalisées pour être supportables.
Alors voilà. Aujourd’hui je vais vous parler de La Monture, et je vais tenter de vous expliquer pourquoi un texte qui avait à-peu-près tout pour me plaire m’a complètement laissé sur le côté, avec une pointe d’agacement final, teintée de profonde lassitude.
Les humains ont été asservis par les Hoots, une race extra-terrestre aux mains hypertrophiés mais aux jambes trop faibles pour les porter, qui ont fait de leurs esclaves des montures de choix. Charley est de ceux-là, un fier Seattle au pedigree prestigieux, destiné à devenir la monture de son Petit-Maître, quant à lui destiné à de grandes choses dans le monde des Hoots. Sauf que surgissent des montagnes des Sauvages, des montures humaines rebelles à l’ordre établi par les Hoots, qui viennent bouleverser le monde de Charley, et avec lui ses certitudes.
Commençons par ce qui m’a plu ou aurait dû me plaire avant de nous tourner vers ce qui m’a posé problème. La Monture est à mes yeux une déconstruction très habile, de l’intérieur, des mécanismes de la domination systémique politico-culturelle. Des yeux de Charley, avec ses mots, on comprend à quel point il est possible de tant faire intérioriser certains réflexes malsains à des gens qu’il en deviennent incapables de questionner même ce qui leur serait absolument intolérable dans des circonstances différentes. Pire, on peut, à force d’éducation perverse qui tiendrait plus du dressage, créer des envies et des besoins de toute pièce dans des personnes qui n’ont alors plus aucune conscience ni personnalité propre. On crée et motive alors des individus avec simplement une liste intériorisée de désirs autorisés et encouragés, selon les critères d’une société qui n’est pas la leur, à laquelle ils appartiennent en tant qu’objets à qui on accorde pas de réel libre-arbitre. Autant dire qu’une telle démonstration, dans le contexte actuel, et avec une réelle acuité, une réelle puissance, avec 20 ans de décalage, j’ai été très impressionné. Vraiment. D’autant plus qu’elle se fait en seulement quelques pages, et ne laisse pas le moindre doute sur les ambitions poursuivies ; j’y ai lu un reflet à peine déformé de ce qui est dénoncé depuis des années et des années par une partie de la population, victime précisément de ces phénomènes malsains, à diverses échelles.
Très honnêtement, pendant ces quelques 20/30 premières pages, j’étais enthousiaste et convaincu.
Sauf que. Sauf que, comme je l’ai dit, un récit littéraire est un ouvrage excessivement fragile qui se construit dans les yeux de cielles qui le lisent. Et il suffit parfois d’un rien pour faire s’écrouler un édifice entier, malgré tous les efforts de l’architecte. Dans mon cas, La Monture s’est tristement effondré bien trop vite, alors même que je voyais le squelette d’un récit très bien pensé et construit demeurer debout sous les décombres. Voyez-vous, ce qui m’agace profondément, c’est que le parti pris narratif décidé par Carol Emshwiller est aussi logique qu’audacieux. L’essentiel du récit nous est effectivement conté par Charley, depuis son point de vue de gamin de 11 ans complètement intoxiqué par la propagande constante des Hoots, faux bienveillants méprisants, condescendants et brutaux. Charley veut tout faire comme on lui dit, être une bonne monture, la meilleure parmi toutes ; on le lit penser, faire, se questionner et répondre lui-même à ses interrogations avec les éléments qu’il parvient à grapiller. Et comme je le disais, c’est cohérent : donc c’est bien. Ça correspond à ce que j’ai dit en introduction ; il s’agit d’aligner les ambitions du récit avec les moyens qu’il se donne pour raconter son histoire au mieux. L’autrice, pour mieux rendre compte des mécanismes sournois qu’elle s’entend dénoncer, nous les donne à lire au plus près de la source, avec un maximum de transparence et de candeur. Ça a tout pour me plaire, en termes d’intentions, vraiment. Et je n’ai cessé, intérieurement, au fil de ma lecture et de mes soupirs, d’essayer de m’aligner moi aussi avec mes exigences de lecteur parfois un peu difficile.
Le problème, c’est qu’un gosse de 11 ans, qui plus est pas forcément très lettré (le texte est un peu trop vague à ce sujet, je trouve), eh bah c’est pénible à suivre. Entre les abrupts changements de sujets, la syntaxe hasardeuse, la caractérisation nébuleuse – puisqu’en cours de construction – les changements d’avis successifs et les contradictions que cela impliquait ; je n’avais pas envie de le suivre, ce gamin, tout simplement, malgré toute l’empathie qu’il pouvait provoquer. Si j’osais ce lieu commun, je dirais que quelque part, ce texte pêche avant tout par ses qualités, et essaie peut-être un peu trop fort de prouver encore et encore ce qu’il a si parfaitement réussi à prouver dès son introduction, jusqu’à l’overdose. Peut-être que comme pour un Vita Nostra, j’ai compris l’astuce trop vite, qu’elle était trop évidente, ou bien que plus simplement, comme pour Le Chien du Forgeron, j’ai eu le sentiment d’être le converti auprès duquel on prêchait.
Dans tous les cas, que ce soit l’une, l’autre ou un mélange des deux ou d’autres non identifiées, en complément de ces impressions, j’ai clairement eu le sentiment de me trouver dans une sorte de vallée dérangeante littéraire. Parce qu’avec de telles ambitions de perfection dans la représentation de la psyché détruite d’un pauvre garçon de onze ans, esclave depuis toujours, servant de monture à des créatures brutales et perverses, soudainement confronté à de nouvelles données qui bouleversent son monde, forcément, la moindre « erreur » crée un décalage cruel pour la lecture. De fait, je n’ai pas compris l’instance de changement de point de vue lors d’un court chapitre, me sortant complètement du récit, comme je ne comprenais pas vraiment certaines occurrences de vocabulaire étrangement poussé pour un garçon qu’on empêche de lire et qui n’a pas beaucoup d’occasions de discuter en profondeur avec qui que ce soit, obsédé par l’idée de devenir un coureur de légende. Tout comme j’ai eu du mal, comme j’en ai toujours, avec des séquences se voulant plus lyriques, jurant complètement avec l’ambiance très pragmatique et autocentrée instaurée jusque là. Je n’ai jamais vraiment su sur quel pied danser, malgré le sentiment à chaque étape de ne voir que trop clairement où l’autrice voulait m’emmener. Il y avait une confusion permanente entre la démonstration induite par le monde dans lequel Charley vit, qui constituait une histoire en soi ; et l’histoire de ce pauvre garçon, perdu dans ce monde dont on sait trop ou pas assez, selon les ambitions affichées ou les circonstances narratives.
À vrai dire, je crois qu’à trop vouloir chasser plusieurs lièvres en même temps, Carol Emshwiller n’a réussi à en attraper aucun, faute d’un volume de récit et d’informations suffisant ou d’un choix assez clair. Ce qui a le don de profondément me frustrer, surtout quand je sens tout le potentiel qui ne sera finalement pas réalisé.
Bref, c’était pas une lecture agréable, clairement. D’un côté une prémisse séduisante, avec beaucoup d’éléments pour la rendre vivante et convaincante, et de l’autre, toutes ces petites choses qui m’on agacé, encore et encore, jusqu’à la lassitude complète et l’envie de juste en finir pour pouvoir passer à autre chose. Ce qui me donne au final le sentiment d’être injuste envers une œuvre exigeante et ambitieuse, qui fournit une sacrée quantité d’efforts pour précisément livrer ce qu’elle promet. Je déteste ça encore plus qu’un vrai mauvais bouquin, parce que j’ai l’impression de ne pas être câblé comme il faut, de me gâcher une potentielle brillante lecture à coup de sur-analyse ou à cause d’un mauvais angle d’attaque, ce contre quoi je ne peux fondamentalement rien, à moins de me reconfigurer entièrement à chaque lecture.
La vérité, c’est que j’aurais aimé, adoré, simplement pouvoir me laisser porter par une histoire racontée d’une façon rafraîchissante et audacieuse. Mais ça n’est pas arrivé, et ce roman m’a au contraire mis un sacré coup de froid que je regrette ; j’aurais sans doute eu besoin, pour une fois, de mieux savoir de quoi il était question avant de m’y plonger, pour mieux m’y préparer.
J’espère que cette chronique fera office de petit coup d’eau sur la nuque, pour que d’autres que moi ne s’y laissent pas prendre de la même façon. Parce que je crois qu’une fois encore, Argyll a fait un choix éditorial qualitatif et audacieux, et que ça mérite quand même qu’on s’y intéresse vraiment.
Au plaisir de vous recroiser.
En attendant, que votre avenir soit rempli d’étoiles. 😉

7 comments on “La Monture, Carol Emshwiller”